
Dossier : Les changements climatiques
1 / Le réchauffement climatique
Le réchauffement.
Les scientifiques sont formels, la température
moyenne globale a monté de 0,3°C à 0,6°C depuis
140 ans. Le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution
du climat, qui réunit plusieurs milliers de chercheurs, estime
que, d'ici à 2100, la température pourrait encore grimper
de 1,5 à 6°C. Ces 140 dernières années (Depuis
que l'on mesure précisément les températures de l'air
et de l'eau), le rythme de croissance est resté modeste mais notable
(entre 0,3°C et 0,8°C). A titre de comparaison, lors du mini âge
glaciaire des 16e, 17e et 18e siècles, la température moyenne
régnant en Europe était inférieure de 0,5°C à
celle d'aujourd'hui.
Depuis les années 1940, cette tendance s'est accélérée.
Les premiers scientifiques à avoir tiré la sonnette d'alarme
l'ont fait au cours des années 1980. En 1990 un consensus scientifique
a été trouvé et les politiques se sont emparés
du dossier.
Le climat varie naturellement, que ce soit au niveau local
(c'est le temps qu'il fait), au niveau régional (anticyclone des
Açores, par exemple) ou au niveau global. Ces évolutions
sont tributaires de très nombreux facteurs naturels et anthropiques.
Les grandes éruptions de volcan émettent tellement de cendres
et de poussières dans la haute atmosphère qu'elles perturbent
momentanément le climat mondial. Les températures ont un
peu baissé après l'explosion du Pinatubo, en juin 1991.
Mais après de tels événements, le cycle naturel se
rétablit. Or, depuis un siècle et demi que l'homme émet
des quantités considérables de gaz renforçant l'effet
de serre naturel, le climat ne fait globalement que se réchauffer.
Ce réchauffement climatique est le plus rapide et le plus important
que l'on ait connu depuis la fin de la dernière ère glaciaire.
Pis, ses effets sont déjà visibles. Les vingt dernières
années auront été les plus chaudes du XXe siècle.
Par effet de dilatation à la chaleur la mer monte lentement (10
à 25 cm en un siècle). Les glaciers fondent et reculent.
Des perturbations climatiques (comme El Nino ou La Nina) se font plus
fréquentes. Les assureurs voient considérablement croître
les notes de remboursement des catastrophes météorologiques.
Bref, le climat change et cela se voit déjà.
Sources : AED - Agence Environnement Développement
- www.aed-dmf.com
A qui la faute ?
Même si l'homme n'est pas intégralement
responsable du réchauffement climatique (le soleil pourrait avoir
sa part), il en reste le grand initiateur. Tout d'abord, parce que depuis
que la révolution industrielle a démarré, les pays
développés puis les pays en développement consomment
énormément de combustibles fossiles (charbon, pétrole,
gaz naturel, houille) pour produire de l'énergie, se chauffer,
se transporter. Or, la combustion de ces combustibles non renouvelables
envoie dans l'air des quantités incroyables de dioxyde de carbone
(CO2). Naturel, inerte et présent dans l'air, le CO2 peut perturber
les cycles climatiques s'il est présent en trop grande quantité
dans l'atmosphère. Pour développer ses villes et ses activités,
l'homme a, par ailleurs, considérablement réduit la surface
des forêts du monde entier. Or, les arbres en croissance stockent
le carbone présent dans l'atmosphère. Moins d'arbres, c'est
plus de CO2 dans l'air. Mais le gaz carbonique n'est pas le seul gaz à
effet de serre. Par certaines de ses activités agricoles (élevage,
riziculture) et industrielles (gestion des déchets, fuites des
réseaux de gaz, mines), l'homme envoie de grandes quantités
de méthane dans l'atmosphère. Et le méthane, aussi,
présent en trop grandes quantités perturbent le climat.
Tout comme l'oxyde nitreux (NO2), l'ozone troposphérique (O3),
les très synthétiques chlorofluorocarbones (CFC) et leurs
substituts (HFC, PFC et SF6). Au total, grâce à l'homme,
on estime que depuis 1750, le taux de CO2 dans l'atmosphère a augmenté
de 30 %. Les effets combinés de tous les autres gaz à effet
de serre équivalent à une augmentation totale de 50 % du
taux de CO2.
Sources : AED - Agence Environnement Développement
- www.aed-dmf.com
Qu'est ce que l'effet de serre ?
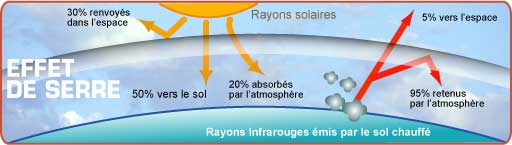
L'effet de serre est un phénomène naturel
qui permet à la terre de conserver une partie de l'énergie
qu'elle reçoit du soleil. Sans effet de serre, la température
moyenne de la terre serait de - 18°C, contre + 15 °C aujourd'hui.
Le schéma est celui-ci : le soleil nous envoie de l'énergie,
essentiellement lumineuse. Cette lumière traverse les hautes couches
de l'atmosphère et réchauffe la surface du globe. Une fois
chauffée, la terre renvoie une partie de sa chaleur vers l'espace,
sous forme de rayons infrarouges. Les gaz à effet de serre naturels
que sont le dioxyde de carbone, le méthane, l'oxyde nitreux, l'ozone,
la vapeur d'eau sont présents dans l'atmosphère. Ils représentent
moins de 1 % de l'atmosphère. Ces gaz empêchent les rayons
infrarouges de repartir directement dans l'espace. Cet effet de serre
permet de maintenir une température moyenne global de 15°C.
Tant qu'il n'y a pas trop de gaz à effet de serre dans l'atmosphère,
la terre renvoie suffisamment de chaleur dans l'espace pour maintenir
un climat constant. Mais si la teneur moyenne de ces gaz vient à
augmenter, la terre renvoie moins de chaleur dans l'espace. Son climat
se réchauffe donc.
Sources : AED - Agence Environnement Développement
- www.aed-dmf.com
Qu'est-ce que les gaz à
effet de serre ?
Les gaz à effet de serre naturels sont la vapeur
d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane, l'oxyde nitreux, l'ozone.
Ils sont " complétés " depuis plusieurs décennies
par les chlorofluorocarbones (CFC - gaz de synthèse) et leurs substituts
(HFC, PFC et SF6). La vapeur d'eau a un rôle complexe, notamment
à cause de l'action jouée par les nuages dans le réchauffement
climatique. Globalement, plus le climat se réchauffera, plus il
y aura d'eau condensée dans l'atmosphère et plus nombreux
seront les nuages qui empêcheraient, eux aussi, la chaleur émise
par la terre de gagner l'espace.
Le dioxyde de carbone est émis par la combustion des combustibles fossiles. A lui tout seul, il est responsable de 60 % de l'accroissement de l'effet de serre. Chaque année, 7 milliards de tonnes de CO2 sont émises, ce qui représentent 1 % de la masse totale de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Même si la moitié de ces émissions sont captées par les arbres et les océans, le taux de CO2 dans l'atmosphère s'accroît de 0,5 % par an.
Le méthane a un important pouvoir d'effet de serre. Depuis qu'il est mesuré, sa concentration a doublé. Les émetteurs sont principalement l'agriculture (la riziculture, l'élevage) et les industries extractives (le grisou des mines, les fuites dans la production et la distribution du gaz de ville). Les décharges d'ordures ménagères sont également de grandes productrices de méthane. Il représenterait entre 15 et 20 % du renforcement de l'effet de serre.
Les oxydes nitreux sont principalement émis par l'agriculture (les engrais azotés) et l'automobile. Leur concentration a augmenté de 15 % depuis qu'il est mesuré. L'ozone est un gaz paradoxal. Si sa concentration diminue en haute altitude au dessus des pôles, ce qui permet aux rayons U.V. du soleil de frapper plus durement l'antarctique et l'arctique, ainsi que la peau et les yeux des habitants de l'hémisphère sud, il est l'un des pire polluants des zones urbaines. Sous-produits de la pollution d'origine automobile, l'ozone a un moindre potentiel effet de serre que le CO2 ou le CH4.
Créés avant guerre, les chlorofluorocarbones sont en diminution depuis leur interdiction par le Protocole de Montréal. Ces trois dernières familles de gaz à effet de serre sont à l'origine de 20 % du renforcement de l'effet de serre.
Au total, les émissions de gaz à effet de
serre dues à l'homme contribuent déjà à retenir
1 % en plus de la chaleur terrestre qui devrait normalement être
évacuées vers l'espace. 1 %, c'est peu, mais cela représente
l'équivalent de l'énergie produite par la combustion de
un million de millions de tonnes de pétrole par an.
Sources : AED - Agence Environnement Développement
- www.aed-dmf.com
Quels seront les effets du
réchauffement climatique ?
Les effets du réchauffement climatique sont
nombreux et sans doute pas tous identifiés. Le plus évident
est une augmentation de la température. Une modification qui devrait
bouleverser certains écosystèmes. Ainsi, les glaciers vont
continuer de fondre et de reculer. Les zones tempérées vont
s'étendre vers le nord de plusieurs centaines de kilomètres.
De même certains déserts vont s'étendre car ils réflechissent
plus la lumière que la fôret. Sous l'effet de la dilatation
à la chaleur, le niveau des mers va monter. Ce qui devrait noyer
certains deltas de fleuves (Rhône, Nil, Gange) et réduire
à néant les infrastructures et l'agriculture qui y ont été
développés. 80% de la population mondiale habite à
proximité des côtes marines ou des cours d'eau. Beaucoup
de petites îles basses (les Maldives, les Seychelles, les Marshall)
seront submergées. L'existence de certains pays ou régions,
comme les Pays-Bas, venise, la camargue serait menacée. Dans le
même temps, le réchauffement accentue la sécheresse
et la désertification. Certaines mers (mer d'Aral, mer Morte) s'évaporent
presque entièrement. Le sud de l'Espagne pourrait devenir une zone
semi-désertique d'ici à 2050. Le régime des précipitations
devrait être modifié. Il pleuvra d'avantage dans certaines
régions et la sécheresse s'abattra ailleurs. Les cyclones
seront sans doute plus nombreux et plus dévastateurs. Sous l'effet
de pluies plus abondantes et d'une augmentation de la concentration en
CO2, la productivité de certaines plantes (blé, riz, orge,
manioc, pomme de terre) devrait sensiblement s'accroître. Des écosystèmes
entiers et très productifs (les mangroves ou les lagons, par exemple)
pourraient disparaître.
Le renforcement de l'effet de serre aura des conséquences directes
pour l'homme. Météorologiques, tout d'abord. Les tempêtes
et les ouragans devraient se multiplier et se renforcer. Des événements
exceptionnels comme les tempêtes de décembre 1999 pourraient
se généraliser. Les inondations des zones côtières
pourraient toucher deux fois plus de monde qu'aujourd'hui si la mer montait
de 50 cm. Certaines régions connaîtront d'importantes pénuries
d'eau. Ces mêmes régions devront faire face à d'importants
problèmes de sécurité alimentaire. Tous ces changements
auront d'inévitables conséquences sanitaires. Ainsi, le
réchauffement climatique augmentera la morbidité (maladies
respiratoires et cardio-vasculaires surtout) et la mortalité dans
les populations urbaines. La raréfaction de l'eau dans certaines
zones fragilisera les populations touchées.
Sources : AED - Agence Environnement Développement
- www.aed-dmf.com
Autres effets mesurés ou prévus
Depuis 1960, le manteau neigeux a déjà diminué de
10% dans les massifs alpins français.
La disparition des espèces animales et de la végétation
: 15 à 30% des espèces végétales
et animales vont disparaître d'ici à 2050 sous l'effet du
réchauffement d'après une étude publiée dans
la revue scientifique " Nature ". Il s'agit donc d'une extinction
massive comparable à celle qui a provoqué la disparition
des dinosaures.
Les poissons d'eau froide, comme le cabillaud ou le merlu seront les premiers
à disparaître. Par contre, les algues risquent d'envahir
les cours d'eau et de pomper toute leur oxygène, en asphyxiant
les poissons qui restent.
Le bâtiment : Au niveau mondial, le nombre de sinistres
de grande ampleur déclarés aux assurances est passé
de 60 en 1970 à 90 en 1980, et à 210 en 2000. Les assurances
vont augmenter leurs tarifs pour compenser leurs frais. Les constructions
vont aussi devoir être plus résistantes et mieux isolées,
donc plus chères.
Les maladies tropicales, en particulier celles transmises
par les moustiques (dengue, fièvre jaune) et les tiques (maladie
de Lyme, infection pulmonaire, encéphalite) vont s'étendre
à des régions jusque là épargnées,
y compris en Europe.
Source "L'internaute 2004"
Lutter contre les changements
climatiques, La Haye et Kyoto
Les systèmes climatiques sont lents, complexes
et intègrent de nombreux " acteurs ", tels que l'atmosphère,
les océans, les forêts, etc. Autant dire qu'ils réagissent
lentement. Or, même si les Nations du monde se mettaient d'accord
pour réduire considérablement (et tenaient leurs engagements)
leurs émissions de gaz à effet de serre, il est peu probable
qu'un retour à un climat normal prenne moins d'un siècle.
Or, aujourd'hui, nous sommes loin de ce scénario imaginaire. La
plupart des pays industrialisés augmentent leurs émissions
de CO2 ou tentent de les stabiliser. Or, pour revenir, à "
moyen terme ", à un climat normal, il faudrait sans doute
réduire de 70 % les émissions de gaz à effet de serre.
Nous en sommes très loin.
La Haye : Chaque année, les pays parties de la convention
cadre sur les changements climatiques se réunissent en une sorte
de grand parlement international, appelé la conférence des
parties (C.P.). En 1998, la quatrième C.P. a adopté le plan
d'action de Buenos Aires. Destiné à renforcer la mise en
application de la convention et du protocole de Kyoto, adopté en
1997. La sixième conférence des parties (c'est-à-dire
le sommet de La Haye) est la date butoir pour l'adoption de mesures importantes,
comme les règles du jeu des mécanismes de développement
propre, les échanges de droits d'émission, la prise en compte
des puits de carbone. Un échec de ce sommet pourrait compromettre
l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto et de la convention.
Kyoto : Le protocole adopté en décembre 1997 à Kyoto
impose aux pays industrialisés de réduire d'au moins 5 %
leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à
leurs niveaux de 1990, au cours de la période 2008-2012. Cet engagement
juridiquement contraignant devrait permettre d'inverser la tendance que
connaissent ces pays depuis un siècle et demi. Pour entrer en vigueur,
le protocole doit être ratifié par au mois 55 pays représentant
au moins 55 % des émissions de dioxyde de carbone de ces pays.
Problème, le sénat américain se refuse toujours à
ratifier le texte. Or, responsables de l'émission de 36 % du monde
industrialisé, les États-Unis disposent d'un véritable
droit de veto à l'entrée en application du protocole de
Kyoto.
Qu'est-ce que la convention cadre sur les changements
climatiques ?
Adoptée le 9 mai 1992, la convention cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (C.C.N.U.C.C. ou U.N.F.C.C. en anglais) a
pour objectif d'empêcher toute perturbation anthropique dangereuse
du système climatique. Elle a été complétée,
en décembre 1997, par le protocole de Kyoto qui fixe des objectifs
juridiquement contraignants aux pays industrialisés, regroupés
au sein des pays de l'annexe I.
Sources : AED - Agence Environnement Développement
- www.aed-dmf.com
Que faut-il faire pour lutter
contre le réchauffement climatique ?
Simple à énoncer mais difficile à
mettre en œuvre : il suffit de réduire de façon considérables
les émissions de gaz à effet de serre. Et notamment dans
les pays industrialisés qui émettent actuellement 75 % de
ces gaz. Cela signifie concrètement qu'il faudra concevoir des
moyens de production d'énergies, des modes de transport, des systèmes
de chauffages émettant considérablement moins de carbone.
Certaines pratiques agricoles (élevage intensif, riziculture) devront
être repensées pour diminuer les rejets de méthane.
Les scientifiques et les économistes pensent qu'avec les techniques
actuelles, il est d'ores et déjà possible d'obtenir des
gains énergétiques de 10 à 30 %. D'autres, comme
le chercheur allemand Ernst von Weiszacker, estiment qu'il est possible
de vivre et de produire autant qu'aujourd'hui en consommant quatre fois
moins de matières premières et d'énergies. C'est
ce que l'on appelle le Facteur 4. Quoi qu'il en soit, investir dans une
société moins polluante ne pourra qu'être rentable.
Pour stabiliser les émissions de carbone, les économistes
estiment que cela coûtera entre - 0,5 % (soit une économie
nette) et 2 % du P.I.B. des pays développés. C'est cher
(2 % du P.I.B. représentent environ 2 000 milliards de francs),
mais beaucoup moins que le coût annuel des catastrophes générés
par un doublement du taux de carbone dans l'atmosphère. Selon le
G.I.E.C., les pays industrialisés pourraient consacrer entre 1
à 3 % de leur P.I.B. contre 2 à 9 % pour les pays en développement.
Sources : AED - Agence Environnement Développement
- www.aed-dmf.com
2 / Autour du climat
Les acteurs
du climat
Alliance des petits états insulaires
(AOSIS) : Coalition de 43 petites îles et pays aux zones
côtières basses qui sont particulièrement vulnérables
à l'élévation du niveau de la mer. Cette association
a été la première à proposer un texte demandant
une réduction importante des émissions de dioxyde de carbone.
Menacés directement par les conséquences du réchauffement
climatique, les pays de l'AOSIS sont, en général, très
actifs dans les négociations internationales liées au climat.
G 77 : Fondé en 1964, dans le contexte de la conférence
des Nations Unies sur le commerce et le développement, le Groupe
des 77 comprend les pays en développement et la Chine. Ils sont
actuellement 134 pays ainsi réunis. Du fait de sa diversité,
le groupe des 77 parvient rarement à parler d'une seule voix..
Groupe Ombrelle : Le groupe Ombrelle (ou Umbrella en anglais) est une coalition d'états dont les positions sont proches de celles des États-Unis. Il est composé de la Russie, de l'Ukraine, du Japon, des États-Unis, du Canada, de l'Australie, de la Norvège et de la Nouvelle-Zélande. Le groupe Ombrelle travaille particulièrement sur les mécanismes du futur marché des permis d'émission. Il est, en général, plus favorables aux solutions économiques et comptables (puits de carbone) qu'aux réelles réductions d'émission.
JUSSCANNZ : Variante du groupe Ombrelle. Il est généralement composé du Japon, des États-Unis, de la Suisse, du Canada, de l'Australie, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, de l'Islande, du Mexique et de la République de Corée. Comme le groupe Ombrelle, il est, en général, plus favorables aux solutions économiques et comptables (puits de carbone) qu'aux réelles réductions d'émission. [haut]
L'Union européenne : En tant qu'organisation d'intégration économique régionale, l'Union européenne est une partie à la convention. Cependant, elle ne dispose pas d'un droit de vote particulier. Elle parle par la voix du pays qui assure sa présidence (la France jusqu'en janvier 2001). Favorable à l'application du protocole de Kyoto, l'Union européenne est néanmoins tiraillée par les positions diverses des 15 pays-membres.
L'Organisation des pays producteurs et exportateurs
de pétrole (OPEP) : Hostiles au processus lié au
protocole de Kyoto, les membres de l'OPEP exigent un dédommagement
financier si les pays industrialisés réduisent leurs émissions
de carbone. Une réduction qui équivaudrait aussi à
une diminution sensible de la consommation de pétrole et de gaz.
Sources EAD
Les puits de carbone
Les océans, les sols et les végétaux
en croissance absorbent naturellement le carbone présent dans l'atmosphère.
Au fond des mers, le carbone est transformé en carbonates. Pour
les mers, on ne peut pas faire grand chose (du moins à grande échelle)
pour augmenter ses capacités de stockage du carbone. En revanche,
on plantant d'avantage d'arbres et en révisant nos méthodes
agricoles, on peut contribuer à faire des forêts et des champs
des " puits de carbone ". Tout le problème est de savoir
quel est le carbone effectivement stocké dans ces puits. Car plus
on a de grands puits, moins on aura d'efforts à produire pour diminuer
ses émissions réelles. Les États-Unis estiment, par
exemple, que ses puits de carbone stockent la moitié de ses émissions.
C'est peu dire que le pays de l'Oncle Sam est très attaché
à développer ce genre de solutions plutôt que de réduire
réellement ses émissions. Pour y voir plus clair, des règles
du jeu doivent être définies, en principe lors du sommet
de La Haye.
Sources EAD
Opération
Carbone en Amazonie : Le climat se
dérègle. Le réchauffement climatique a déjà
commencé et risque de s’amplifier. Que faut-il faire pour
le limiter ? Réduire les émissions de gaz à effet
de serre dues aux activités humaines, dont le principal est le
gaz carbonique ? Bien sûr. Mais pourquoi pas, aussi, réabsorber
une partie des gaz déjà émis ? Le débat est
ouvert. Au fin fond de l’Amazonie, une expérience forestière
est actuellement menée à l’initiative de Peugeot et
conduite par l’Office national des Forêts (Fazenda São
Nicolau). Elle a pour but de mieux apprécier la pertinence de l’utilisation
des forêts comme puits de carbone – un système qui
absorbe plus de carbone qu’il n’en émet. Voici, pour
bien cerner les enjeux de cette aventure écologique et humaine,
un rappel du contexte : qu'est-ce que l'effet de serre et en quoi nos
activités augmentent les risques de changement climatique; quel
rôle les forêts peuvent jouer contre le réchauffement
?
Sources : Cité des sciences (exposition opération
Carbone 2004)
Pathologies
liées aux variations climatiques
À supposer que la Terre se réchauffe,
les modifications de l'écosystème retentiront sur les vecteurs
des maladies transmissibles.
Dans moins d'un demi-siècle, les vagues de chaleur semblables à
celle de 1976, espacées jusqu'alors de trois cent dix ans, pourraient
se répéter tous les cinq ans, ce qui permettrait au moins
une acclimatation physiologique et comportementale.
D'autres phénomènes climatiques retentissent
sur la santé : on recense
Des traumatismes et des troubles psychiatriques (dépression,
suicide)
Des diarrhées, des infections respiratoires,
ainsi que des épidémies de leptospirose (Nicaragua, 1995),
liées aux inondations.
L'émergence du Hantavirus Sin Nombre,
responsable d'une pathologie respiratoire mortelle aux États-Unis
en 1993, pourrait être liée à la pullulation des rongeurs,
elle-même provoquée par d'intenses pluies torrentielles dues
à El Niño (et à l'abondance de nourriture).
El Niño serait aussi responsable d'épidémies
de choléra au Bangladesh (1980-2001).
Des épidémies de cryptosporidiose
ont été contemporaines de pluies torrentielles aux États-Unis,
tandis que la malnutrition est une compagne de la sécheresse.
Une augmentation de la mortalité respiratoire
a été attribuée à la pollution atmosphérique
par l'ozone lors de pics de température
L'asthme, les bronchites ont été
corrélés aux feux de forêt en Malaisie et au Brésil.
Si le réchauffement climatique annoncé (entre 1 °C et 5 °C) survenait comme prévu, on prévoit pour 2100 une augmentation de la prévalence du paludisme dans les pays d'Afrique, où il sévit déjà, et sa réapparition en Asie centrale. Et les difficultés d'accès à l'eau potable seraient exacerbées, ce qui va de pair avec les maladies diarrhéiques.
Les moustiques
Peut-il y avoir un déplacement des maladies infectieuses tropicales
vers nos contrées ? Y a-t-il déjà des prémices
d'un tel phénomène ?
Les isothermes se déplaçant, on risque d'avoir un déplacement
des vecteurs comme certains moustiques, qui pourraient venir s'abriter
dans nos contrées. Les prémices d'un tel phénomène
ne sont pas encore perceptibles par rapport à la latitude, mais
ont déjà été constatés en altitude.
Dans les années quatre-vingt-dix, il y a eu une importante épidémie
de dengue à Mexico, où le moustique s'était installé
en raison d'un réchauffement inhabituel de la température
dans cette ville, d'ordinaire plutôt fraîche, car située
à 2 000 mètres. Des moustiques vecteurs pourraient remonter
vers le pourtour méditerranéen, d'où ils sont en
principe absents. Certains ont été retrouvés en Iltalie
Autres effets indirects : Le réchauffement de la Terre pourrait
allonger la période de migration des oiseaux dans nos contrées
et de circulation des moustiques vecteurs du virus West Nile, et donc
augmenter les chances de contact avec la population.
La veille des maladies.
Ce n'est pas tant la surveillance des maladies que la veille qui importe,
et cette veille doit concerner aussi bien les virus animaux que les virus
humains. Les études écologiques sont indispensables pour
mieux connaître les réservoirs animaux et les vecteurs afin
de pouvoir intervenir sur leur cycle et ainsi interrompre la transmission.
Il faut aussi mieux connaître les virus existants (on n'en connaît
pas 10 %), pour être prêt à les diagnostiquer lorsqu'ils
émergent chez l'homme.
par Christine Maillard (Le Concours Médical
du 30 juin 2004 n°24)
Un entretien avec Vincent DEUBEL - Directeur de l'unité de biologie
des infections virales émergentes, institut Pasteur, Lyon
Un rapport publié
à la suite d'un colloque scientifique ( mai 2004 à l'Unesco
à Paris) donne une image contrastée des liens
entre les émissions humaines de gaz à effet de serre et
les océans.
1/ les océans capturent près de la moitié des émissions
humaines de gaz carbonique (CO2).
2/ ce CO2 augmente l'acidité de l'eau de mer, ce qui menace probablement
la survie à long terme de nombreuses espèces marines.
Depuis le début de l'ère industrielle au XIXe siècle,
les eaux marines de la planète ont accumulé environ 118
milliard de tonnes
de carbone, produit de la combustion du charbon, du pétrole et
du gaz naturel
D'après Christopher Sabine, premier auteur de la publication et
chercheur de la NOAA
(administration américaine chargée
de l'étude de l'océan et de l'atmosphère) à
Seattle, l'océan serait capable d'absorber chaque année
environ un tiers de toutes
les émissions humaines de CO2
Au cours des cent prochaines années, le changement de l'acidité
devrait être d'une ampleur trois fois plus importante et cent fois
plus rapide que ceux subis entre les périodes glaciaires.
Ces eaux plus acides s'accompagneraient d'une baisse de la concentration
d'oxygène et de nutriments près de la surface.
"Ces changements affecteraient beaucoup d'espèces et changeraient
la composition des communautés biologiques dans une proportion
et d'une façon qui ne sont pas encore prévisibles et compréhensibles
à ce jour"
Autre conséquence, l'absorption du CO2 par l'eau de mer diminue
fortement les quantités de carbonates dont de très nombreux
organismes comme les mollusques, les coraux et certaines espèces
de plancton, ont absolument besoin pour construire leurs squelettes ou
leurs coquilles. La situation est particulièrement préoccupante
pour les coraux, dont on sait déjà qu'ils sont par ailleurs
très sensibles à des augmentations de température
même faibles.
Extrait d'un article de cyrille Vanlerberghe
- Le figaro - 21/07/04
D'ou viennent les pluies acides?
New York a déclaré dernièrement
qu'il adopterait des mesures d’urgence afin de diminuer le smog
et les pluies acides induits par les émissions polluantes.
Ces mesures sont nécessaires afin de protéger la population.
Des mesures temporaires permettront déjà de diminuer l'équivalente
à retirer 300.000 voitures des rues de New York d'ici 2007.
A l'état naturel, la pluie est légèrement
acide dans l'atmosphère. Les acides se forment lorsque les gaz
de dioxyde de carbone et de chlore réagissent à l'humidité.
Les pluies acides sont causées principalement par deux polluants
atmosphériques communs produits par les combustibles fossiles brûlés
: le dioxyde de soufre (fonderies et centrales électriques) et
les oxydes d'azote (automobiles.)
Ces polluants peuvent se déplacer sur des milliers de kilomètres
dans l'atmosphère, où ils se mélangent à la
vapeur d'eau pour former une solution légère d'acide sulfurique
et nitrique. En Europe, où prédomine le vent d'ouest, la
Grande-Bretagne cause ainsi de graves torts à la Norvège,
la France et à l'Allemagne. La pluie, la neige, la grêle,
le brouillard et les autres précipitations amènent cette
solution sur la terre sous forme de pluies acides.
Ces dernières nuisent également à la faune marine
sur la côte atlantique. Elles sont l'une des causes du dépérissement
des lacs et des forêts en raison des dépôts acides,
secs et humides (France : Vosges). Elles peuvent aussi provoquer des troubles
respiratoires et circulatoires chez l'homme (à New York entre autre).
Le terme smog fait référence à un mélange
toxique de polluants atmosphériques que l'on peut souvent observer
sous forme de brume diffuse dans l'air.
Sources : Divers dont Actu-environnement 10/09/2004
